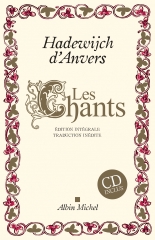 Albin Michel publie un beau livre collaboratif sur des poèmes strophiques chantés (45 chants) de la Béguine mystique Hadewijch d'Anvers. Les commentaires sont de Veerle Fraeters et Frank Willaert et la traduction française de Daniel Cunin. Un CD de 13 des 45 chants en néerlandais est inclus.
Albin Michel publie un beau livre collaboratif sur des poèmes strophiques chantés (45 chants) de la Béguine mystique Hadewijch d'Anvers. Les commentaires sont de Veerle Fraeters et Frank Willaert et la traduction française de Daniel Cunin. Un CD de 13 des 45 chants en néerlandais est inclus.
Redécouverts il y a moins de 200 ans, Les Chants ont pour thème "la Minne", soit l'amour mystique entre Dieu et l'homme qui demeure, quelles que soient les saisons (métaphore des épreuves).
Au 13ème siècle, les Béguines étaient des groupes de femmes en quête de perfection spirituelle mais non soumises au clergé. La chanson populaire à partir de mélodies de trouvères (troubadours) de l'époque était un bon moyen d'initiation car "la répétition constante de mots clés (amour, désir, fidélité) révélait une grande valeur méditative".
Hadewijch était une de leur guide pour cheminer vers le parfait Amour. Ses poèmes réalistes et sans concessions évoquent souvent le pôle sombre et méconnu de l'Amour.
...Avant que tout soit uni à tout
On goûte à d'amères souffrances (16)
...En toute saison il doit souffrir
Celui qui veut servir la haute amour... (17)
L'Amour exige, l'Amour est un joug (efforts et douleurs sont connivents au service de la minne) avec lequel il convient de cohabiter corps et âme dans la patience et la persévérance.
...C'est une façon bizarre de vous terrasser
Plus elle aime, plus elle accable... (17)
Avec ces chants il s'agit d'exhorter, de raffermir l'ardeur de la foi devant une ascèse qui peut parfois prendre des années avant d'en espérer des fruits réguliers (la pratique des vertus).
Certes les signes ravissent les novices mais sans fermeté d'âme ou résistance du corps, les efforts peuvent s'avérer vains.
Par moments Hadewijch rappelle le lot, le trésor de cœur escompté, tel un horizon entrevu subrepticement et atteignable pour certaines et certains, dans la longue et âpre course de fond, tel un jalon sur le chemin :
Le prix de la Miséricorde et la dette de la loi,
L'amant les paie au début.
Une fois qu'il possède cette fougue,
Il se met à faire d'immenses profits :
Il accomplit chaque travail sans difficulté,
Il endure chaque souffrance sans douleur,
C'est une vie au -delà de l'entendement humain (20)
...Mais celui qui est altier et sage
parvient à Te suivre en tout,
Dans le doux, dans l'aigre, dans le confort, dans la crainte,
Jusqu'à ce qu'il sache tout à fait ce que Tu attends de lui
Quand Tu lui montres Ta volonté aussi clairement,
Sa douleur se trouve apaisée...(40)
A l'écoute des chants on pourrait les croire lourds ou graves, il n'en est rien. Chantés seul ou à plusieurs ils clament la légèreté d'âme et sont d'une beauté épurée. Cœurs enjoués déclament des paroles paradoxalement émanant d'un cœur que l'on pourrait croire contrit et l'on comprend pourquoi ces "Liederen" constituent aujourd'hui l'une des fiertés nationales des Flandres et des Pays-Bas. Ils sont la Mémoire d'une ascèse mystique, identique en tout temps et par conséquent universelle.
Un extrait du chant 18 : Groeter goede vore den tide
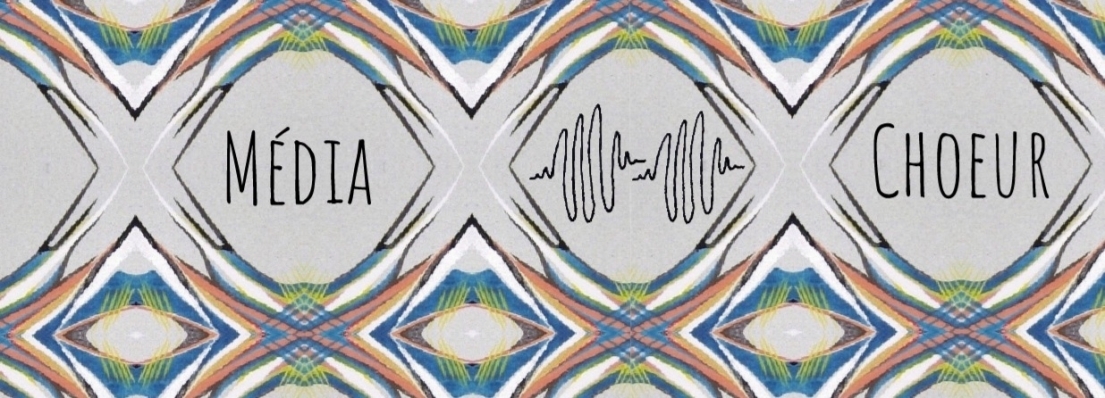

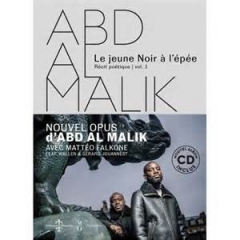 Nouveau projet artistique généreux pour Abd Al Malik qui depuis quelques années est en fait sur disque un quatuor d'artistes avec sa femme Wallen, son frère Bilal et son ami Mattéo Falkone.
Nouveau projet artistique généreux pour Abd Al Malik qui depuis quelques années est en fait sur disque un quatuor d'artistes avec sa femme Wallen, son frère Bilal et son ami Mattéo Falkone.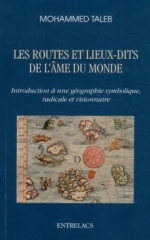 Mohammed Taleb est un philosophe algérien musulman ouvert sur le monde et en dialogue avec d'autres cultures ou spiritualités que la sienne.
Mohammed Taleb est un philosophe algérien musulman ouvert sur le monde et en dialogue avec d'autres cultures ou spiritualités que la sienne.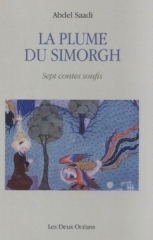 L'univers de ces contes est parsemé de jalons : le Guide/double mystérieux, le passage secret, l'île ou lieu inconnu, les pouvoirs magiques, les symboles numineux (Le Livre de la vie, l'Homme vert, le Maître des oiseaux, Le Simorgh, La Pierre de rêve...). Seul la fin du monde, le dernier conte, s'apparente plus à une nouvelle fantastique.
L'univers de ces contes est parsemé de jalons : le Guide/double mystérieux, le passage secret, l'île ou lieu inconnu, les pouvoirs magiques, les symboles numineux (Le Livre de la vie, l'Homme vert, le Maître des oiseaux, Le Simorgh, La Pierre de rêve...). Seul la fin du monde, le dernier conte, s'apparente plus à une nouvelle fantastique. 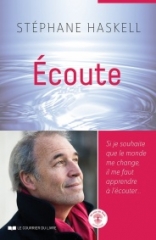 le nom de Stéphane Haskell, écrivain, photojournaliste et réalisateur, est associé à un documentaire devenu célèbre : Yoga, un souffle de liberté. Suite à de graves problèmes de santé au dos et guéri en partie grâce à la découverte d'une pratique de yoga célèbre, il parcourait le monde à la découverte de quelques figures notoires de cette ascèse bénéfique pour le corps et l'esprit.
le nom de Stéphane Haskell, écrivain, photojournaliste et réalisateur, est associé à un documentaire devenu célèbre : Yoga, un souffle de liberté. Suite à de graves problèmes de santé au dos et guéri en partie grâce à la découverte d'une pratique de yoga célèbre, il parcourait le monde à la découverte de quelques figures notoires de cette ascèse bénéfique pour le corps et l'esprit.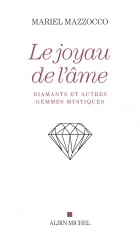 Mariel Mazzocco s’intéresse, dans le cadre de son domaine d'étude universitaire aux mysticisme médiéval et à celui de l'âge baroque.
Mariel Mazzocco s’intéresse, dans le cadre de son domaine d'étude universitaire aux mysticisme médiéval et à celui de l'âge baroque.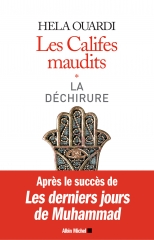 La déchirure est le premier de cinq volumes des Califes maudits paru chez Albin Michel et écrit d’une main de maître par Hela Ouardi, qui est entre autre professeur de littérature et de civilisation française à l’université de Tunis.
La déchirure est le premier de cinq volumes des Califes maudits paru chez Albin Michel et écrit d’une main de maître par Hela Ouardi, qui est entre autre professeur de littérature et de civilisation française à l’université de Tunis.